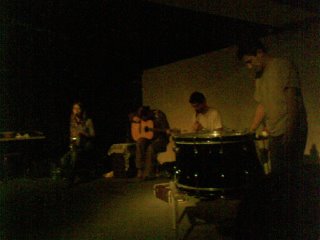Pour notre plus grand plaisir et intérêt, dans la petite salle du théâtre Monnot à Achrafieh, reprise des concerts de musique improvisée libre initiés par le collectif libanais MILL, organisateur du festival Irtijal.






des artistes de différents endroits du monde partagent leurs expériences d'écoute et de pratique des musiques improvisées, expérimentales, inclassables.
Pour notre plus grand plaisir et intérêt, dans la petite salle du théâtre Monnot à Achrafieh, reprise des concerts de musique improvisée libre initiés par le collectif libanais MILL, organisateur du festival Irtijal.






[...] L'argent et le pouvoir sont à prendre pour qui les veut, presque un cadeau, il n'est même pas difficile de s'en emparer. Ce sont bien sûr les escrocs les plus habiles qui emporteront la mise. Toutes les réticences sont devenues inadéquates, tous les distinguos ont disparu. Il n'y a plus de classes supérieures que l'on désire se concilier, ou dont on veut obtenir les faveurs ; il n'y a plus de classes inférieures auxquelles on doive rendre des comptes. Il n'y a plus d'opinion publique. Il n'y a personne pour manifester son mépris de tout cela, hormis une poignée d'entre nous (...). (C'est une chose connue à Zurich, où tout cela ne les intéressait pas, que Lénine vécut en face du café Voltaire. Il n'alla jamais y discuter ; il avait son jardin à cultiver. La seule défense irréductible que je connaisse, même si elle n'est pas victorieuse, est la liberté d'expression. Manifestement l'art ne dit rien à la majorité des gens, mais il est difficile de se tromper sur le sens du mot NON.) Les dirigeants ne veulent pas s'embêter à faire des distinctions entre les faibles qui de toutes façons n'ont aucun pouvoir, Ils simplifient donc. Plus les masses sont homogènes, plus il devient facile d'en tirer de l'argent, de les exploiter, de concocter des guerres. Pour la génération de chefs d'entreprise de l'époque Reagan, tout cela n'est qu'un jeu d'enfants, qu'à la surprise générale ils ont gagné, un monde à la struwwelpeter, un monde de jeux cruels. Pour leurs successeurs immédiats, la seconde génération, qui espère le pouvoir et l'argent, les menaces deviendront réalité, la répression sera efficace, les guerres préventives : c'est-à-dire que des guerres seront nécessaire pour se garantir contre leur fin. Soyez sur vos gardes, le déclin des Etats-Unis ne sera pas aussi pacifique que celui de l'Empire britannique, ou de l'Union soviétique.
[...] Mais une justification d'ordre plus général (anthropologique) ici s'impose - que je résumerai ainsi. Comment comprendre, en effet, cette dimension "morale" de l'émotion, et son pouvoir sur nous (sa valeur d'art) ? Pour les Chinois, l'émotion est une "réaction" à l'incitation du dehors (gan) qui nous met en branle intérieurement (dong). Elle est d'autant plus profonde en nous que ce à quoi nous réagissons - à l'extérieur de nous - est important - d'un grand enjeu. Aussi, plus elle est profonde, moins elle est individuelle, limitée à notre intérêt personnel (égocentrée) : plus elle nous fait éprouver, au contraire, la richesse du lien qui nous relie au monde et combien nous sommes partie prenante du grand procès des choses. Elle ouvre alors notre subjectivité à la solidarité des existences, à l'interdépendance des réalités, la fait sortir de son point de vue particulier - exclusif et borné. C'est en raison de cette intensité qu'elle est en mesure de nous faire "communiquer" au travers du réel, de nous élever à une perspective communautaire (le sens du ren confucéen) : plus elle est profonde, donc, plus elle est morale. Plus elle peut aussi ébranler les autres en profondeur et sans limitation d'objet ou d'intérêt. Ainsi, la vocation morale de l'émotion ne rétrécit pas le sens, ne réduit pas ses possibilités (comme dans notre poésie moralisante et didactique) ; au contraire, en l'enracinant davantage (je veux dire : en le faisant davantage accéder, à travers notre sensibilité, au "fondement" des choses et de la vie), elle déploie d'autant mieux celui-ci - jusqu'à l'infini. Et c'est cette portée du sens qui fait sa beauté.

Du 8 au 25 février j'ai effectué une tournée aux USA (The Great Snowball Tour'08) avec Jack Wright, Andrea Neumann et Wade Matthews (Portland & Seattle). Sur le chemin nous avons joué avec d'autres invités et changé d'endroit presque tous les jours. Voici quelques clichés des lieux où nous avons joué durant la tournée. Ces photos, prises avec mon téléphone portable, sont de piètre qualité mais elles ne sont là que pour témoigner de la diversité des lieux qui nous ont été proposés.

 Je joue un trio avec Bonnie Jones (élec.) et Paul Neidhardt (perc.) et un trio avec Andy Haylek (perc. et scie) et Andrea Neumann (cadre de piano, table de mixage). Tous présents sur la photo.
Je joue un trio avec Bonnie Jones (élec.) et Paul Neidhardt (perc.) et un trio avec Andy Haylek (perc. et scie) et Andrea Neumann (cadre de piano, table de mixage). Tous présents sur la photo. le Velvet Lounge, n'est pas très grand et se présente sur deux étages. En bas le bar et en haut la salle de concert. Il y fait froid...
le Velvet Lounge, n'est pas très grand et se présente sur deux étages. En bas le bar et en haut la salle de concert. Il y fait froid... Nous attendons dans le bar l'arrivée de l'ingé-son. Nous allons jouer avec les musiciens de la veille, comme vous pouvez le constater.
Nous attendons dans le bar l'arrivée de l'ingé-son. Nous allons jouer avec les musiciens de la veille, comme vous pouvez le constater. La salle de concert pas adaptée à la diffusion électroacoustique nous vaut quelques tensions avec le technicien pas du tout sensible à nos besoins. Il a fallut beaucoup de calme et de tact pour obtenir de jouer au sol devant les speakers. L'acoustique sur la scène est déplorable mais dans la salle ont peut espérer une amélioration notable. Le public est peu nombreux et réceptif.
La salle de concert pas adaptée à la diffusion électroacoustique nous vaut quelques tensions avec le technicien pas du tout sensible à nos besoins. Il a fallut beaucoup de calme et de tact pour obtenir de jouer au sol devant les speakers. L'acoustique sur la scène est déplorable mais dans la salle ont peut espérer une amélioration notable. Le public est peu nombreux et réceptif. La salle où nous jouons avec comme invités Bryan Eubanks (élec.) et Tucker Dulin (tromb.). L'acoustique est celle d'une chambre standard, plutôt agréable à jouer. On sent un public surtout spécialiste.
La salle où nous jouons avec comme invités Bryan Eubanks (élec.) et Tucker Dulin (tromb.). L'acoustique est celle d'une chambre standard, plutôt agréable à jouer. On sent un public surtout spécialiste. Je joue un court solo de 20 mn et un quartet avec Jack, Andrea et Bryan.
Je joue un court solo de 20 mn et un quartet avec Jack, Andrea et Bryan. D'autres musiciens nous rejoignent, Andrew Drury (perc.) et Gregory Reynolds (sax ténor).
D'autres musiciens nous rejoignent, Andrew Drury (perc.) et Gregory Reynolds (sax ténor). Pendant l'installation nous sommes dérangés par le déclenchement d'une alarme à incendie qui nous oblige à quitter les lieux, puis à y revenir. Le chalumeau d'un ouvrier qui travaille dans une galerie au même étage en est la cause... Le son est bon comme dans un cube de béton. L'audience est réduite et plutôt familière.
Pendant l'installation nous sommes dérangés par le déclenchement d'une alarme à incendie qui nous oblige à quitter les lieux, puis à y revenir. Le chalumeau d'un ouvrier qui travaille dans une galerie au même étage en est la cause... Le son est bon comme dans un cube de béton. L'audience est réduite et plutôt familière. Je joue un trio avec Jack et Andrea. L'alarme à incendie se déclenche pendant le concert.
Je joue un trio avec Jack et Andrea. L'alarme à incendie se déclenche pendant le concert. Wade s'installe en attendant les autres musiciens, Jean-Paul Jenkins (g.) et Matt Hannafin (perc.). La salle tout en longueur est haute et le son est très bon. Le public n'est pas très nombreux et très réceptif.
Wade s'installe en attendant les autres musiciens, Jean-Paul Jenkins (g.) et Matt Hannafin (perc.). La salle tout en longueur est haute et le son est très bon. Le public n'est pas très nombreux et très réceptif. Je joue en duo avec Wade puis en quartet additionné de Matt et Jean-Paul.
Je joue en duo avec Wade puis en quartet additionné de Matt et Jean-Paul. Les concerts ont lieu dans cette très grande salle à l'acoustique étonnement assez mat et trompeuse, la Chapel Performance Space. Le public est conséquent, habitué mais assez indulgent.
Les concerts ont lieu dans cette très grande salle à l'acoustique étonnement assez mat et trompeuse, la Chapel Performance Space. Le public est conséquent, habitué mais assez indulgent. Le premier soir je joue un solo, et le second soir je joue un duo avec Gust Burns (piano) et un autre duo avec Wade Matthews (laptop).
Le premier soir je joue un solo, et le second soir je joue un duo avec Gust Burns (piano) et un autre duo avec Wade Matthews (laptop). Installation des musiciens après une balade dans le port, le front de mer et l' Olympic Sculpture Park de Seattle. La salle est tout en long avec une scène ridicule au fond. L'acoustique n'est pas très bonne. Le public est nombreux et toujours aussi indulgent en apparence !
Installation des musiciens après une balade dans le port, le front de mer et l' Olympic Sculpture Park de Seattle. La salle est tout en long avec une scène ridicule au fond. L'acoustique n'est pas très bonne. Le public est nombreux et toujours aussi indulgent en apparence ! L'espace est contigu à la cafétéria et au resto U. Il est cossu, tout en boiseries et canapés de cuir. On s'attend à voir arriver de très nombreux(ses) étudiant(e)s curieux(ses) mais nous y avons eu peut-être notre plus réduite audience. Le son est très bon.
L'espace est contigu à la cafétéria et au resto U. Il est cossu, tout en boiseries et canapés de cuir. On s'attend à voir arriver de très nombreux(ses) étudiant(e)s curieux(ses) mais nous y avons eu peut-être notre plus réduite audience. Le son est très bon. L'espace n'est pas très bien adapté à la musique du fait d'un mur de séparation qui le coupe en deux et nous oblige à avancer dans la salle. On se retrouve avec un espace, à moitié vide et à moitié plein, dans le dos. Le bruit de la rue et des visiteurs ne rendent pas le lieu totalement silencieux. L'audience est plutôt familière.
L'espace n'est pas très bien adapté à la musique du fait d'un mur de séparation qui le coupe en deux et nous oblige à avancer dans la salle. On se retrouve avec un espace, à moitié vide et à moitié plein, dans le dos. Le bruit de la rue et des visiteurs ne rendent pas le lieu totalement silencieux. L'audience est plutôt familière. La galerie est une sorte de fourre tout de tableaux, d'objets d'artisanat, de poteries. Nous jouons dans une sorte d'arrière salle exiguë derrière la vitrine du fond. L'ambiance est très amicale, nous partageons un repas fait maison.
La galerie est une sorte de fourre tout de tableaux, d'objets d'artisanat, de poteries. Nous jouons dans une sorte d'arrière salle exiguë derrière la vitrine du fond. L'ambiance est très amicale, nous partageons un repas fait maison. Pour l'occasion Reuben Radding (contrebasse) se déplace de New-York. Un gros chat roux est couché dans un des fauteuils. Le concert sera vraisemblablement très intimiste. L'acoustique n'est pas trop mauvaise. Le public principalement constitué d'amis est très réduit.
Pour l'occasion Reuben Radding (contrebasse) se déplace de New-York. Un gros chat roux est couché dans un des fauteuils. Le concert sera vraisemblablement très intimiste. L'acoustique n'est pas trop mauvaise. Le public principalement constitué d'amis est très réduit. Je joue deux trios avec Reuben et Jack et un duo avec Reuben.
Je joue deux trios avec Reuben et Jack et un duo avec Reuben. Le lieu favorise principalement la diffusion des pratiques expérimentales. L'audience est nombreuse et très jeune. Majoritairement des étudiant(e)s en art contemporain venu(e)s de l'université de la ville. L'acoustique n'est pas excellente mais l'écoute est relativement bonne.
Le lieu favorise principalement la diffusion des pratiques expérimentales. L'audience est nombreuse et très jeune. Majoritairement des étudiant(e)s en art contemporain venu(e)s de l'université de la ville. L'acoustique n'est pas excellente mais l'écoute est relativement bonne. La radio WKCR de la Columbia University m'a invité à venir jouer un solo dans leur studio. Je dois dire que cette perspective m'excite énormément. J'adore la radio et ce contexte particulier de la diffusion réellement acousmatique. L'équipe est composée d'étudiants jeunes et très efficaces. J'ai convié Bryan à me rejoindre pour une session complémentaire en duo. La pièce est assez bordélique, tout semble d'un autre temps; vieux magnéto à bandes Studer, canapé défoncé, piano en piteux état. Mais contre toute attente l'acoustique est très bonne.
La radio WKCR de la Columbia University m'a invité à venir jouer un solo dans leur studio. Je dois dire que cette perspective m'excite énormément. J'adore la radio et ce contexte particulier de la diffusion réellement acousmatique. L'équipe est composée d'étudiants jeunes et très efficaces. J'ai convié Bryan à me rejoindre pour une session complémentaire en duo. La pièce est assez bordélique, tout semble d'un autre temps; vieux magnéto à bandes Studer, canapé défoncé, piano en piteux état. Mais contre toute attente l'acoustique est très bonne. Dans la journée je retrouve Dave Gross (sax alto) devant la Downtown Music Gallery. Un marchand de disques de jazz et de musique improvisée très réputé et qui régulièrement accueille des concerts dans l'exiguïté de son espace. Nous faisons d'abord un peu le tour du quartier puis décidons d'aller à pieds jusqu'à la Knitting Factory. Nous en profitons pour traverser Chinatown, flâner et discuter d'art, de rock, de philosophie du son et refaire le monde de la musique expérimentale... en buvant des coups.
Dans la journée je retrouve Dave Gross (sax alto) devant la Downtown Music Gallery. Un marchand de disques de jazz et de musique improvisée très réputé et qui régulièrement accueille des concerts dans l'exiguïté de son espace. Nous faisons d'abord un peu le tour du quartier puis décidons d'aller à pieds jusqu'à la Knitting Factory. Nous en profitons pour traverser Chinatown, flâner et discuter d'art, de rock, de philosophie du son et refaire le monde de la musique expérimentale... en buvant des coups. La Knitting Factory est une usine à gaz ! Plusieurs niveaux et des concerts partout en même temps. Ce qui pose quelques soucis de cohabitation entre les genres. Beaucoup plus axé sur le rock et le jazz, le lieu a progressivement délaissé les musiques improvisées et il semble que ce soir nous fassions le dernier concert de ce genre.
La Knitting Factory est une usine à gaz ! Plusieurs niveaux et des concerts partout en même temps. Ce qui pose quelques soucis de cohabitation entre les genres. Beaucoup plus axé sur le rock et le jazz, le lieu a progressivement délaissé les musiques improvisées et il semble que ce soir nous fassions le dernier concert de ce genre. Nous jouons dans la salle la plus en sous-sol. Comme terrée on fond d'un trou sous un plafond assez bas et une acoustique affreuse. Le son à peine émis se vautre littéralement à nos pieds.
Nous jouons dans la salle la plus en sous-sol. Comme terrée on fond d'un trou sous un plafond assez bas et une acoustique affreuse. Le son à peine émis se vautre littéralement à nos pieds. La très talentueuse et sympathique Andrea Neumann à Philadelphia. J'espère bien ne pas avoir a attendre trop longtemps avant que nous rejouions ensemble.
La très talentueuse et sympathique Andrea Neumann à Philadelphia. J'espère bien ne pas avoir a attendre trop longtemps avant que nous rejouions ensemble. L'énergique et très engagé Jack Wright, que je suis certain de retrouver avec plaisir un jour en vadrouille en Europe, ni jamais trop loin de ma porte !
L'énergique et très engagé Jack Wright, que je suis certain de retrouver avec plaisir un jour en vadrouille en Europe, ni jamais trop loin de ma porte ! Et enfin, Bryan Eubanks un excellent musicien et maintenant ami, avec lequel j'ai eu beaucoup de plaisir à jouer. Je ne doute pas que nos routes se croisent de nouveau très rapidement.
Et enfin, Bryan Eubanks un excellent musicien et maintenant ami, avec lequel j'ai eu beaucoup de plaisir à jouer. Je ne doute pas que nos routes se croisent de nouveau très rapidement.
La salle noire de l’espace Jemmapes est, c’est bien connu, un endroit à la fois incontournable et pourtant peu fréquenté dans le paysage parisien des musiques expérimentales, proposant bien souvent des formations de choix sous la programmation judicieuse et participative de Pascal Marzan. C’est aussi, sans rapport de cause à effet, un endroit particulièrement bruyant – l’unanimité en conviendra facilement – mal isolé, relégué à une extrémité du bâtiment et juxtaposé aux toilettes mixtes continuellement fréquentées dès les premières notes émises. Cela étant, cet aspect n’est pas forcément problématique en soi et se doit en cela d’être pris en compte par les musiciens qui s’y exposent.
Le vendredi 18 mai, nous avons pu écouter deux soli de musiciens à l’écoute attentive. Il s’agissait tout d’abord de Marc Baron au saxophone alto, auquel succéda Seijiro Murayama aux percussions dont le dispositif réduit comprenait une caisse claire et une cymbale. Je n’avais jamais entendu auparavant Marc Baron en solo, ne le connaissant qu’à travers l’excellent quatuor de saxophone auquel participent également Bertrand Denzler, Jean-Luc Guionnet et Stéphane Rives, et j’étais pour cela particulièrement curieuse de l’écouter dans cette expérience singulière qu’est pour « tout » musicien le solo.
Ce set dura environ 45 minutes durant lesquelles le silence, c’est-à-dire l’écoute par le musicien et le public d’une part de l’absence de son émis par le premier et d’autre part des rumeurs environnantes, prit une place considérable, à l’instar des performances de Taku Sugimoto ou de Radu Malfatti, fidèles compagnons de parties d’échecs animées. Sur ce fond de silence venaient alors se poser, avec précision mais aussi avec un certain caractère brut et détendu – c’est-à-dire simple au sens propre du terme et éloigné de toute perspective esthétisante –, quelques sons isolés, répétés selon divers agencements choisis hic et nunc conférant par là-même une dimension aléatoire à leur succession ; sons rares et clairsemés à la typologie réduite : souffle court, médium propice aux harmoniques, suraigu tenu et scintillant.
Cependant aussi attentive que fut cette écoute, celle-ci me sembla ne pas pouvoir considérer à leur juste mesure les bruits alentours, s’inscrire parmi eux afin d’y trouver une place qui profiterait pleinement du jeu indécis entre bruits et sons musicaux. L’une des raisons de cette position d’écart qui ne parvient pas à faire sien l’espace qui l’accueille était ici sans doute due en partie à la quasi absence de variations dans la dynamique des différents sons que Marc Baron nous souffla. Une dynamique piano pour l’essentiel, comme en position de retrait, cherchant une sympathie de climat dans les va-et-vient du couloir adjacent qui quant à eux n’y prêtaient guère attention, mais offraient, par ce même mouvement, la richesse ordinaire des rapports de volume de nos actions quotidiennes.
Cette caractéristique de la salle noire de l’espace Jemmapes prit un tout autre sens dans le second set de cette soirée. Là point de retrait, mais des sons parmi les sons, des gestes qui ne prêtaient pas une attention excessive à leur environnement, simplement occupés par leur mouvement dont la répétition durable, mais aussi différenciée, laissait place subtilement à leur résonance. Ce set de Murayama dura 30 minutes et se divisait en deux plages symétriques, l’une à la cymbale frottée dont la périphérie entrechoquait de temps à autre la surface de la caisse claire, provoquant ainsi de légers heurts harmoniques et l’autre à la seule caisse claire frappée dans un geste rapide et continu par des baguettes aux différentes qualités de timbre. Set rigoureux au formalisme assumé. Dès lors les spécificités du lieu ne l’étaient plus tant, convergeant vers un espace autre et pourtant non différencié que l’on aimerait appeler musique.
« A propos de ces souvenirs, j’ai détruit le cinéma, parce que c’était plus facile que de tuer les passants. »
Le mercredi 2 mai a eu lieu à la galerie Immanence un concert de Mattin en hommage aux Hurlements en faveur de Sade de Debord. Il s’agissait là d’un concert qui s’intéressait à la forme même du concert et qui dès lors s’apparentait davantage à une performance. La galerie était vide, sans scène ni musiciens ; comme seule présence autre que le maigre public réuni, des haut-parleurs en position frontale et quelques spots dirigés ici et là sur le public. Selon une partition similaire au film de Debord, la performance vit se succéder deux longues plages de bruit blanc diffusé à très haut volume, la pièce plongée dans un noir complet, entre lesquelles s’intercalait une plage de silence de durée voisine, la pièce cette fois-ci sur-éclairée par les spots allumés de manière synchrone avec l’arrêt net du bruit.
Le bruit blanc, son sans qualités par excellence, agissait dans les deux plages à la manière d’une masse. L’écoute ne s’adressait alors plus tant aux oreilles et leur ascendant habituel, mais au simple corps - matière convoquée dans sa présence. Cette adresse au corps du public - sa position d’écoute mais aussi sociale – était dirigée durant l’interlude plus spécifiquement vers la vue, mise à l’épreuve par l’éblouissement des spots silencieux, mais aussi en retour vers l’ouie, assourdie, reprenant par degrés lents sa place dans la hiérarchie des sens. Ces concerts sont finalement rares dans le champ des musiques expérimentales et pourtant ce sont ceux-là mêmes qui lui donnent un sens.
rédaction en cours, texte non définitif

 Le Festival Irtijal (improvisation en arabe) créé en 2000 est organisé à Beyrouth par l'association Mill. On peut lire sur le site d'Irtijal cette note en préambule du tout premier concert : La première performance publique semi-officielle de musique improvisée libre au Liban. Depuis cette année fondatrice, le groupe de musiciens défricheurs composé de Christine Sehnaoui, Sharif Sehnaoui et Mazen Kerbaj (Rouba3i), œuvrant chaque année à faire découvrir une programmation de plus en plus internationale, a contribué à faire exister une scène d'expérimentation musicale composée maintenant d'un petit noyau dur très actif (Marc Codsi, Charbel Haber, Mayaline Hage-Boutros, Jassem Hindi, Bechir Saade, Raed Yassin). Aux Instants Chavirés, est organisé ce week-end Irtijal-Paris, une dizaine de concerts en soutien au festival libanais fragilisé depuis l'instabilité régionale de l'été 2006, et rassemblant quelques uns des artistes ayant participé aux éditions libanaises précédentes. Nous nous trouvons alors dans une attitude d'écoute transformée car, bien avant de juger de la musique, on ressent - tout comme les artistes - l'importance de faire acte de présence. Irtijal-Paris ouvre par des projections de films de Raed Yassin - 'Beyrouth consacré aux marginaux de la banlieue de la capitale - et Irtijal '05 de Patrick Bœuf et Sara Sehnaoui, témoignage visuel de la conduction d'un orchestre d'improvisation par Markus Eichenberger (le Domino Workshop Ensemble); images du workshop et du concert mêlées de vues de Beyrouth, de détails d'architecture, de sons urbains, d'appel à la prière, de circulation routière,... Un repas libanais, en milieu de soirée, suspend momentanément dans une convivialité chaleureuse le rythme soutenu des concerts. La musique, de tenue inégale mais toujours intéressante, confirme que la scène libanaise d'improvisation existe pleinement, émancipée de ses modèles occidentaux. Post-rock, free jazz, pop expérimentale, électronique, performance, video, convergent dorénavant autour de ce centre activiste beyrouthin pour créer au Moyen-Orient probablement l'unique courant d'expérimentations artistiques plurielles. Le public, constitué en grande partie de la diaspora libano-parisienne, manifeste un contentement de groupie bien étonnant mais totalement réjouissant, assez éloigné des réactions communes d'une audience rompue aux musiques les plus exigeantes.
Le Festival Irtijal (improvisation en arabe) créé en 2000 est organisé à Beyrouth par l'association Mill. On peut lire sur le site d'Irtijal cette note en préambule du tout premier concert : La première performance publique semi-officielle de musique improvisée libre au Liban. Depuis cette année fondatrice, le groupe de musiciens défricheurs composé de Christine Sehnaoui, Sharif Sehnaoui et Mazen Kerbaj (Rouba3i), œuvrant chaque année à faire découvrir une programmation de plus en plus internationale, a contribué à faire exister une scène d'expérimentation musicale composée maintenant d'un petit noyau dur très actif (Marc Codsi, Charbel Haber, Mayaline Hage-Boutros, Jassem Hindi, Bechir Saade, Raed Yassin). Aux Instants Chavirés, est organisé ce week-end Irtijal-Paris, une dizaine de concerts en soutien au festival libanais fragilisé depuis l'instabilité régionale de l'été 2006, et rassemblant quelques uns des artistes ayant participé aux éditions libanaises précédentes. Nous nous trouvons alors dans une attitude d'écoute transformée car, bien avant de juger de la musique, on ressent - tout comme les artistes - l'importance de faire acte de présence. Irtijal-Paris ouvre par des projections de films de Raed Yassin - 'Beyrouth consacré aux marginaux de la banlieue de la capitale - et Irtijal '05 de Patrick Bœuf et Sara Sehnaoui, témoignage visuel de la conduction d'un orchestre d'improvisation par Markus Eichenberger (le Domino Workshop Ensemble); images du workshop et du concert mêlées de vues de Beyrouth, de détails d'architecture, de sons urbains, d'appel à la prière, de circulation routière,... Un repas libanais, en milieu de soirée, suspend momentanément dans une convivialité chaleureuse le rythme soutenu des concerts. La musique, de tenue inégale mais toujours intéressante, confirme que la scène libanaise d'improvisation existe pleinement, émancipée de ses modèles occidentaux. Post-rock, free jazz, pop expérimentale, électronique, performance, video, convergent dorénavant autour de ce centre activiste beyrouthin pour créer au Moyen-Orient probablement l'unique courant d'expérimentations artistiques plurielles. Le public, constitué en grande partie de la diaspora libano-parisienne, manifeste un contentement de groupie bien étonnant mais totalement réjouissant, assez éloigné des réactions communes d'une audience rompue aux musiques les plus exigeantes.